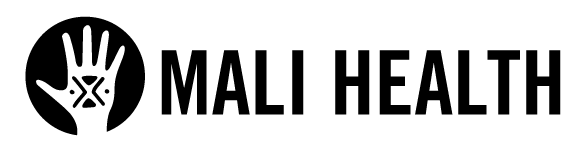A la rencontre de l’ASACO BAKON
Dans le système de santé décentralisé du Mali, les ASACO (associations de santé communautaire) jouent un rôle déterminant non seulement dans la fourniture de services de soins de santé primaires – en particulier les soins de santé maternelle et infantile – mais elles sont également la principale structure qui assure la participation communautaire et l’appropriation locale.
Créée en 1994 par des membres de la communauté de la Commune III, ASACO – BAKON dessert cinq quartiers (Badialan I, II et III – Kodabougou et Niomérambougou) de Bamako. Bien que deux communautés voisines collaborent souvent pour créer un ASACO, et que certaines communautés aient plusieurs ASACO pour répondre aux besoins de grandes populations, il est unique que cinq communautés se réunissent pour le faire. Mais les dirigeants de l’ASACO-BAKON, conscients de l’importance du rôle de l’ASACO, ont décidé de mettre en commun leurs ressources pour s’assurer une plus grande chance de succès.
ASACO – BAKON a été l’une des premières associations de santé communautaire créée au Mali. Bien qu’elle ait été confrontée à des défis au cours de ses près de 30 ans d’histoire, en septembre 2019, un nouveau groupe de jeunes dirigeants a été élu pour entrer au comité de direction de l’ASACO et ils se sont consacrés à l’amélioration des performances de leur centre de santé. Ils ont commencé à chercher des partenaires pour les aider dans leurs efforts, et quatre mois après l’élection du nouveau président de l’ASACO, M. Aboucar Maiga, il a rencontré Mali Health comme leur premier partenaire technique.
Grâce au partenariat entre l’ASACO – BAKON et Mali Health, le personnel de santé travaillant au CSCom et les membres de l’ASACO ont participé aux formations de Mali Health sur les éléments de notre approche participative d’amélioration de la qualité. Les formations ont porté sur des sujets liés à la santé maternelle, néonatale et infantile, y compris les soins obstétricaux et néonatals d’urgence de base, ainsi que le rôle et la fonction de l’ASACO et de ses organes de gestion. À la suite de ces sessions de formation, le personnel et les membres d’ASACO signalent une amélioration de la confiance et de l’alignement dans l’ensemble du centre de santé, ce qu’ils n’avaient jamais connu auparavant. Les nouvelles compétences du personnel du centre de santé ont permis d’améliorer les indicateurs clés, qu’ils ont maintenus chaque année, ainsi que d’augmenter les consultations et les accouchements assistés au centre de santé.
L’ASACO se réunit régulièrement et conformément aux statuts. Chaque personne en charge comprend son rôle. Mali Health a également été en mesure de fournir certains équipements pour soutenir l’amélioration de la qualité des services du centre de santé, notamment un microscope pour que le centre puisse effectuer des travaux de laboratoire et une table chauffante pour les nouveau-nés.
Le vice-président de l’ASACO, Mahamadou Sissoko, décrit les changements qui s’opèrent au centre de santé : « Le partenariat avec Mali Health a apporté un changement radical dans les pratiques de notre centre de santé. Nous avons fait de la satisfaction des patients notre priorité absolue, et la communauté nous voit maintenant différemment. Aujourd’hui, nous avons beaucoup plus de succès.
Pour soutenir davantage la santé des communautés desservies par le centre de santé, Mali Health s’associe aux femmes de la communauté par le biais de nos stratégies de financement de la santé dirigées par des femmes, notamment en les aidant à organiser des groupes d’épargne santé, à développer des activités génératrices de revenus et à devenir des membres votants de l’ASACO.
Les dirigeants d’ASACO – BAKON continuent de rechercher des partenariats pour améliorer la qualité de leur centre de santé. Dans le cadre d’une collaboration passionnante visant à améliorer leur infrastructure, ils ont travaillé avec des partenaires pour construire une maternité dont ils avaient tant besoin.