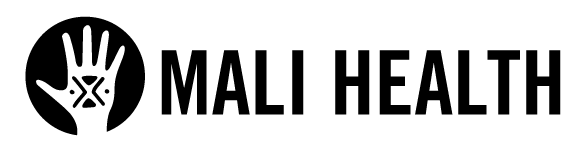Améliorer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire en réduisant les déchets organiques
Après une collecte de données approfondie et un engagement communautaire dans les phases 1 et 2, les activités d’économie circulaire ont commencé par la création de coopératives de compostage et de jardinage. D’après nos recherches communautaires, nous avons constaté que 57 % des déchets générés dans les communautés périurbaines sont organiques et peuvent être compostés, transformant les déchets non gérés en une ressource précieuse.
À partir de janvier, 180 femmes ont formé avec succès 4 coopératives à Kalabambougou, Sikoro et Sabalibougou et ont commencé à acquérir des compétences en jardinage, en compostage et en gestion coopérative.

Notre collecte de données de base a révélé des résultats intéressants.
Les 180 femmes participant au projet pratiquent des activités de jardinage pour leur subsistance et comme principale activité génératrice de revenus depuis au moins 5 ans. Nous nous attendions à ce que le compostage soit une idée nouvelle – et seulement 4 d’entre eux ont démontré des connaissances en matière de compostage. Mais près de la moitié d’entre eux, 88 sur 180, avaient des connaissances limitées en jardinage. Ce résultat indique à quel point les ressources sont limitées pour ce groupe de femmes, ce qui valide le besoin important du projet et amène notre équipe à se concentrer davantage sur la maîtrise des compétences de base. De plus, vingt femmes avaient déjà de solides connaissances en gestion coopérative.
Environ 21 % des participantes au projet (38 femmes sur 180) ont déclaré n’avoir aucun revenu, les revenus mensuels pour le reste du groupe variaient de 3000 FCFA (environ 5 $) à 22826 FCFA (environ 38 $). Parmi celles qui avaient un revenu mensuel, seulement 8 femmes ont déclaré en avoir assez pour pouvoir épargner et mettre de l’argent de côté pour leurs besoins futurs.
La plupart des femmes qui participent au projet ont participé à nos groupes d’épargne santé, et 80 % (144 femmes sur 180) savaient quoi faire lorsqu’il y avait un besoin de santé pour elles-mêmes ou leur famille. Sans fonds suffisants pour agir sur la base de ces connaissances, la capacité de prendre des décisions pour protéger leur santé peut être limitée, mais heureusement, ils peuvent contracter des prêts auprès de leurs groupes d’épargne pour aider à répondre à ces besoins.

L’un des résultats les plus importants et les plus immédiats du projet a été son impact sur la sécurité alimentaire des femmes et de leurs familles. Comme elles cultivent des légumes, les femmes sont non seulement en mesure de générer des revenus grâce à la vente de leurs produits sur les marchés locaux, mais elles sont également en mesure de fournir des produits frais à leurs ménages. Dans les communautés où l’accès à des aliments nutritifs est limité et où les prix sont souvent prohibitifs, l’accès à cette ressource a un impact immédiat sur la santé des enfants et des familles.
Les activités de compostage s’intensifient, alors que les coopératives mettent de l’ordre dans leurs systèmes de collecte et de distribution. Ils collectent déjà les déchets organiques là où la majorité est générée, sur les marchés locaux, et ils réfléchissent à la manière de gérer des opérations de collecte plus larges. Grâce à l’ensemble de leurs activités, les femmes disposeront non seulement d’une source locale de nutriments pour améliorer la santé des sols de leurs propres jardins, mais elles pourront également vendre leur compost à d’autres. Les engrais sont l’un des intrants les plus coûteux pour les jardiniers et les cultivateurs de Bamako – et leur compost sera une alternative abordable.

Le projet favorise un sentiment d’appartenance à la communauté et de collaboration entre les participants, alors qu’ils travaillent ensemble à la gestion de leurs coopératives et à l’échange de connaissances sur les pratiques agricoles durables. Leurs efforts collectifs permettent de renforcer le capital social qui non seulement améliore la cohésion sociale, mais accroît la résilience locale face aux défis économiques auxquels elles sont confrontées.
Alors que les activités de jardinage et de compostage continuent de croître, les coopératives commenceront les activités de tri et de recyclage du plastique en 2025. D’après nos recherches, nous avons constaté que le plastique représentait 14 % de tous les déchets générés, de sorte que le détourner pour le recyclage et la réutilisation est la prochaine étape vers la construction d’une économie circulaire et zéro déchet.